| Information: |
La pyramide de Khéphren, également appelée pyramide de Khafra (nom grec de Khéphren), est située sur le plateau de Gizeh, à proximité de celles de Kheops (son père) et de Mykérinos (son fils ou successeur). Érigée vers 2 530 avant J.-C., elle est la deuxième plus grande pyramide d’Égypte, bien qu’elle semble plus haute que celle de Kheops en raison de sa position légèrement surélevée sur le plateau.
Elle reflète la pleine maturité de l’architecture pyramidale de l’Ancien Empire, durant la IVe dynastie, marquant l’apogée d’un système de construction alliant maîtrise technique, puissance symbolique et efficacité funéraire.
Une architecture d’élévation... et de creusement
Si l’édifice s’impose visuellement par son élévation monumentale (hauteur actuelle : 136 mètres, hauteur d’origine : 143,5 mètres), il témoigne aussi d’une architecture souterraine complexe. Cette volonté de creusement dans la masse rocheuse est particulièrement visible dans l’aménagement de la chambre funéraire, creusée partiellement dans le substrat rocheux naturel et partiellement maçonnée.
Ce choix n’est pas anodin : il renforce la protection de la sépulture tout en rattachant symboliquement le tombeau au sol sacré d’Égypte. Ce double mouvement – vers le ciel et vers la terre – illustre une pensée architecturale plus aboutie, combinant monumentalité visible et espace intérieur invisible, réservé au défunt divinisé.
Matérialité et composition
La pyramide de Khéphren est bâtie selon un plan classique : base carrée, pentes régulières d’environ 53°, et parement extérieur en calcaire fin de Tourah, dont une partie est encore visible à son sommet, offrant un rare témoignage du revêtement d’origine.
Le noyau interne est constitué de blocs massifs de calcaire brut, taillés localement, posés en assises horizontales. Certains blocs pèsent plusieurs tonnes. L’intérieur comprend :
Un couloir descendant menant à une chambre funéraire
Une chambre principale partiellement creusée dans la roche
Un sarcophage de granit noir intégré au sol
Des chambres annexes et vestibules, associés au rituel funéraire
Le complexe funéraire s’étend bien au-delà de la pyramide elle-même. Il comprend :
Un temple haut, adossé à la pyramide
Une chaussée pavée de 500 m menant au temple bas
Le célèbre Sphinx, souvent attribué au règne de Khéphren, qui semble faire partie intégrante du dispositif symbolique du complexe
Une synthèse de la monumentalité classique
Contrairement aux pyramides de Sekhemkhet, Khaba ou Lepsius n°1, la pyramide de Khéphren est achevée, parfaitement fonctionnelle, et conçue dans une logique de pérénnité. Elle conserve toutefois un lien symbolique avec les premières pyramides, notamment par l’intégration d’espaces creusés, montrant que la volonté d’inscrire la sépulture dans la profondeur terrestre n’a jamais été abandonnée, même à l’époque des grandes pyramides lisses. |
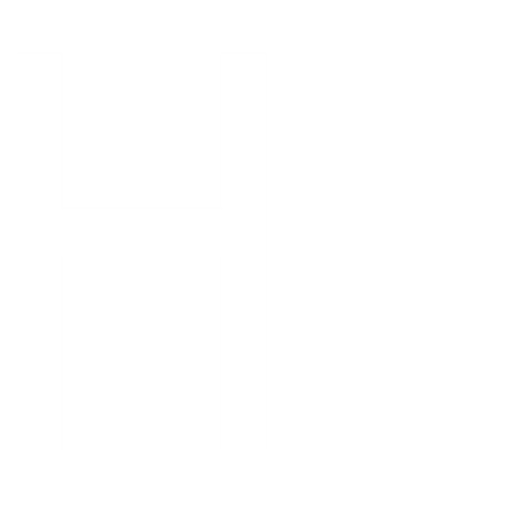 Aide
Aide
 Pyramide de Khéphren - Gizeh
Pyramide de Khéphren - Gizeh